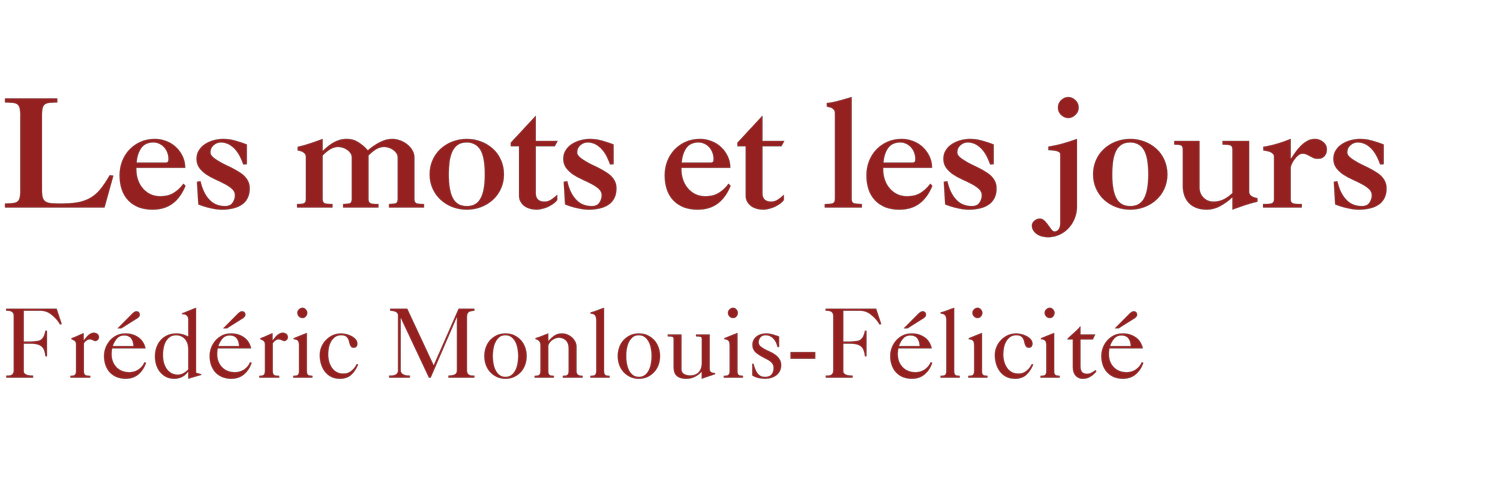Ukhnaagiin Khürelsükh !
Ceci n’est pas un cri de guerre. C'est un nom venu de loin. Celui de l’ex-Premier ministre de Mongolie dont on a appris la démission à la fin du mois de janvier. Sa faute ? Le traitement inhumain infligé à une mère infectée par le Covid-19, transférée depuis un hôpital vers un centre spécialisé. Une vidéo montrant cette malade en simple pyjama dans la rue avec son nouveau-né par une température de -25 degrés a déclenché une manifestation à laquelle le Premier ministre a réagi en présentant sa démission.
Il serait audacieux de présumer que les manifestants des rues d’Oulan Bator soient plus violents que nos black-blocks et autres Gilets jaunes. Si l’on écarte l’hypothèse d’une démission sous la pression de la rue, on peut bien sûr trouver d’autres explications à cette décision, où le calcul politique peut avoir sa place. Mais on peut tout aussi naïvement supposer qu’une notion oubliée dans nos contrées, celle de responsabilité, a servi de guide à M. Khürelsükh.
Il était une fois un pays où les chefs se tenaient pour responsables non seulement de leurs actes et décisions, mais aussi des actes et des décisions de leurs subordonnées, voire des subordonnés de leurs subordonnés. Et dans ce pays, les chefs se sentaient aussi responsables des actes non accomplis (je donne un ordre, et il ne se passe rien) et des décisions non prises (tant que je ne donne pas d’ordre, il ne passe rien). Et chose encore plus extraordinaire, c’est un pays dans lequel celui qui prononçait la phrase « je suis entouré d’incapables, il faut que je fasse tout moi-même dans ce bazar » était immédiatement puni de trente coups de fouet, suivi d’un bannissement à vie.
Mais comme je vous parle d’un pays que les moins de cent ans ne peuvent pas connaître, revenons à celui que nous connaissons. Depuis une année de crise épidémique majeure, nous avons systématiquement failli, à toutes les étapes. Pas de masques, pas de gel. Pas de tests. Pas de vaccins. Valse-hésitation devant les anti-vaccins. Refus du passeport vaccinal au nom d’un égalitarisme mou. Des vaccinations qui s’arrêtent le vendredi à 18h et reprennent le lundi matin. Contamination dans les hôpitaux. Pas de vaccination par les médecins. Et les pharmaciens attendent les doses qui n’arrivent pas. Suspension injustifiée du vaccin Astra Zeneca. N’en jetez plus. Si nous avions été vraiment en guerre, c’est un mai 40 que nous aurions connu. Chaque semaine de retard de vaccination coûte environ 2 Mds d’euros de PIB, sans parler des centaines de contaminations et des dizaines de décès additionnels. Il est devenu – enfin ! – évident que vacciner est la priorité des priorités et la seule façon de justifier tous les sacrifices consentis depuis une année. Et pourtant il a fallu deux mois avant de rappeler timidement à l’ordre les personnels soignants pour qu’ils veuillent bien consentir à se vacciner. S’il vous plaît. Et ce n’est que depuis début mars que l’on vaccine – dans certains centres - le week-end.
On aimerait qu’une contrainte beaucoup plus forte s’applique sur ces opérations vitales, pour alléger le plus vite possible les restrictions de liberté qui pèsent sur une population heureusement disciplinée-résignée (pour l’instant). Il ne s’agit pas de sous-estimer la complexité de la gestion de cette crise, qui implique un arbitrage permanent et au jour le jour pour trouver la « moins pire des solutions ». À l’opposé d’une conception idéale de l’action politique comme capacité à transformer le réel avec une vision de long terme. Mais enfin, il est temps de sonner la mobilisation générale qui est restée largement incantatoire jusqu’à présent.
Et à la fin, on ne peut s’empêcher de penser avec mélancolie aux steppes mongoles. Car, à bien y réfléchir, aucun ministre ni aucun haut-fonctionnaire français n’a démissionné à la suite des ratés de la gestion de la pandémie. Aucun n’a été remplacé par plus compétent ou plus efficace. Les plus cyniques diront qu’il ne resterait pas grand-monde aujourd’hui. Le dernier ministre à avoir démissionné l’a fait pour des raisons électorales (Benjamin Griveaux) avec le succès que l’on sait. En revanche, nous sommes submergés par nombre d’élus qui se disent « en capacité de » et « en responsabilité ». De toute évidence, plus ces expressions sont utilisées, moins elles traduisent que les personnes qui les profèrent sont responsables et capables.
Plus tristement, cela signifie que personne ne se sent responsable de rien ni de personne. Cette dilution de la responsabilité d’un appareil politico-administratif d’abord tourné vers la perpétuation des positions de pouvoir de ses acteurs n’est pas nouvelle. Mais par temps de crise, elle jette une lumière crue sur nos faiblesses. Ukhnaagiin Khürelsükh !