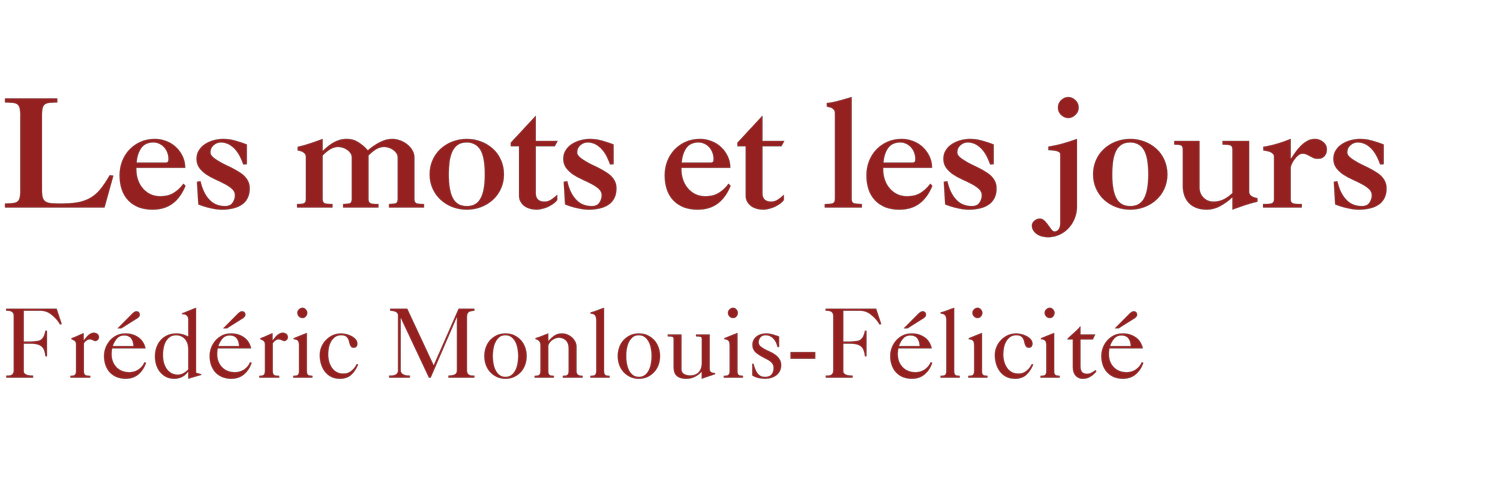Pourquoi le vaccin anti-Covid doit être obligatoire
S’il est une fable qui ne convainc personne, c’est bien celle d’une France qui sortirait plus forte de la crise. En revanche, une France qui sortirait plus vite de la crise est un scenario qui ne tient qu’à une décision.
Mi-novembre, des laboratoires ont annoncé la mise au point de différents vaccins contre le Covid-19 mais le débat sur son caractère obligatoire peine à s’imposer. Depuis neuf mois, le monde entier se lamente sur l’inexistence d’un vaccin. Au moment où il arrive, il est proprement stupéfiant de découvrir un sondage indiquant qu’un Français sur deux ne souhaite pas se faire vacciner. Étonnamment, peu d’experts plaident pour rendre le vaccin obligatoire, alors que les mêmes s’alarment de la saturation du système hospitalier et des effets sanitaires à long terme pour les malades qui guérissent. Les épidémiologistes estiment que l’immunité collective sera acquise si 60 à 70% de la population française est vaccinée, ce qui rend aléatoire toute stratégie fondée sur le volontariat. L‘hypothèse d’une vaccination obligatoire se heurte immédiatement à deux difficultés. Sur le plan médical, des incertitudes entourent encore l’efficacité et les effets à long terme ou secondaires des vaccins. Sur le plan politique, la nébuleuse des anti-vaccins, qui transcende les frontières idéologiques classiques, fait craindre l’ouverture d’un nouvel incendie que les pouvoirs publics seraient incapables de circonscrire au moment où la société est déjà dangereusement fracturée. Et pourtant, s’il est un domaine dans lequel l’autorité de l’État devrait s’appliquer sans tergiverser, c’est bien celui de la vaccination contre le Covid-19.
Les opposants à la vaccination obligatoire veulent en général avoir la preuve irréfutable que le ou les vaccins autorisés en France sont efficaces et sans effets secondaires. Sur un plan plus pratique, il est aussi souhaitable qu’ils soient gratuits et largement disponibles. Faute de compétences scientifiques suffisantes, suspendons un instant notre jugement. On ne parle pas ici de poudre de perlimpinpin ou du vaccin Spoutnik V développé en Russie dans la grande tradition d’opacité soviétique, mais de vaccins issus des plus sérieux laboratoires pharmaceutiques du monde ou des start-ups les plus innovantes. Cette présomption de performance et de fiabilité, même si elle ne garantit pas 100% d’innocuité et d’efficacité devrait cependant assurer un socle minimum d’acceptabilité. Quant à la gratuité et à la disponibilité, c’est une condition sine qua non d’une large couverture vaccinale.
Le sujet est en réalité bien plus politique que médical. Il met en jeu l’autorité, la responsabilité et la cohérence des pouvoirs publics. La maladie a déjà tué plus de 50 000 personnes en France. En regard des ressources colossales qui ont été mobilisées pour répondre à la pandémie et des dégâts considérables sur l’économie et la société, il est en réalité incompréhensible qu’au moment où une protection crédible voit le jour, on ne rende pas celle-ci universelle. Dans les années soixante-dix, plus 10 000 personnes mouraient sur les routes tous les ans, principalement faute de ceinture de sécurité, que celle-ci n’équipe pas les voitures ou que les conducteurs ne jugent pas bon de l’attacher. Par habitude, négligence ou au nom de leur liberté, les opposants à la ceinture obligatoire trouvaient celle-ci inutile (« je n’en ai pas besoin, je suis un bon conducteur »), inefficace (« ça ne sert à rien, Gérard l’avait et ça ne l’a pas sauvé »), voire dangereuse (« ça fait plus de mal que de bien »). Effectivement, mal attachée, mal positionnée, ou dérisoire face à la violence de la collision, la ceinture ne garantit pas de sortir indemne d’un accident ou d’y survivre. Mais son absence est une quasi-garantie de blessure fatale. Les opposants prônaient surtout le libre choix, refusant de considérer le coût social de leur mort ou du traitement médical de leurs blessures ou de leur handicap. Par ailleurs, le risque que faisaient courir les passagers arrière aux passagers de l’avant, propulsés sur eux en cas de choc, était couramment minimisé. L’obligation du port de la ceinture n’est pas allée de soi : au nom de la liberté individuelle, il ne fallait surtout pas protéger les Français malgré eux. En 1973, ce fut par une demi-mesure que la ceinture devint obligatoire hors agglomérations et uniquement à l’avant. Il a fallu attendre 1990 pour généraliser son port à l’avant et à l’arrière. Ce n’est qu’en 2002 que son absence est devenue une infraction occasionnant le retrait de trois points sur le permis de conduire. Avec l’abaissement des vitesses, les radars, l’amélioration des routes et des équipements de sécurité des véhicules, le bilan parle de lui-même : 16 500 morts en 1972, 10 000 en 1990 et 3500 en 2019. Qui peut sérieusement remettre en question aujourd’hui la pertinence de cette mesure pourtant vigoureusement contestée à l’époque ? Le devoir de l’État de protéger sa population a trouvé dans la sécurité routière l’un de ses terrains d’application les plus remarquables.
C’est cette même logique qui devrait s’appliquer aujourd’hui, en évitant de reproduire les décennies de procrastination perdues pour la sécurité routière. D’abord pour protéger la population. Ensuite parce que le coût collectif de la non-vaccination est tout simplement insupportable pour une économie dévastée. Et accessoirement pour que les 85 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2020 au prix d’une dette à 120% du PIB n’aient pas été engagés en vain. Parce qu’à la logique palliative sans fin du « je dépense donc je suis » doit se substituer une logique de reconstruction. Protéger les Français consiste à remettre le plus vite possible le pays en ordre de marche, pas à subventionner l’arrêt de l’activité. Pour cette raison, il est vital de ne pas attendre le bon vouloir de la population. Il faut donc obliger les malades et les cas contacts à s’isoler, et les y aider matériellement. Il faut rendre la vaccination obligatoire, et faire appliquer cette obligation. Les moyens ne manquent pas, par exemple en en faisant une condition pour l’accès à l’emploi (à l’instar de la visite médicale d’embauche), pour la perception de prestations sociales ou l’accès à des équipements collectifs. C’est très exactement la logique qui prévaut pour les onze vaccins exigés à l’admission des enfants en crèche ou à l’école. De même, certains pays conditionnent l’obtention d’un visa de séjour à une vaccination contre la variole et la rougeole, administrés sur place.
C’est un test pour l’autorité de l’État autant que pour la cohérence de ses choix, et d’abord celui d’avoir accordé la primauté à la vie humaine sur toute autre considération. S’il recule devant l’obstacle, le « quoi qu’il en coûte » aura été un « coût pour rien ».