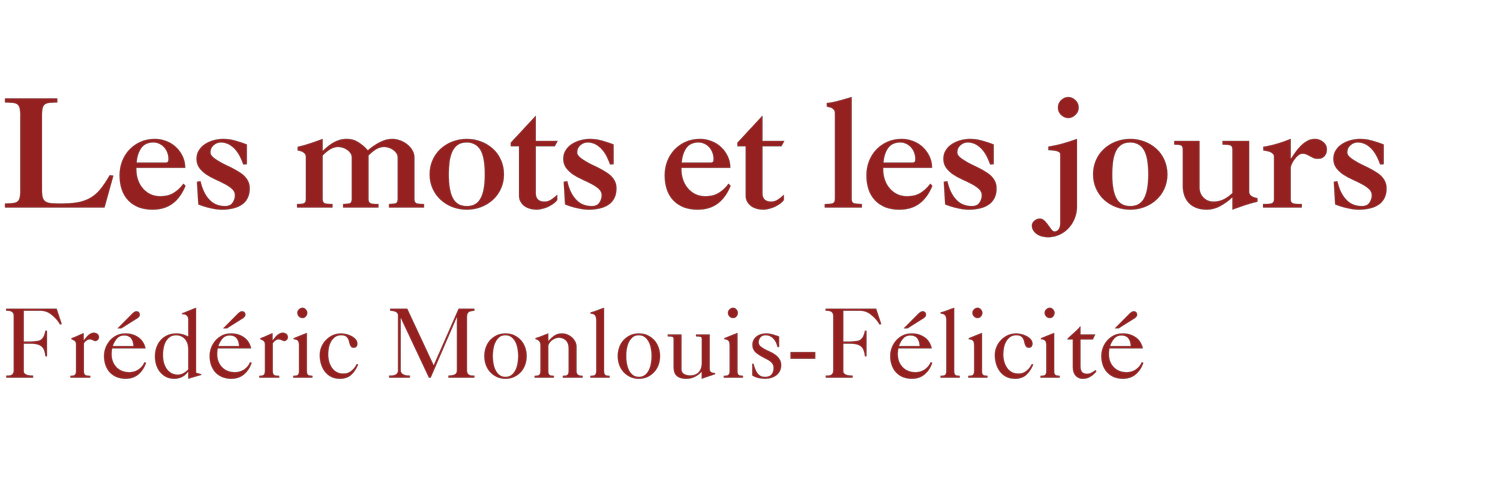Démocratie d’empêchement
« (...) nous sommes entrés dans un âge indissociablement faible et négatif du politique. Les « refusants » contemporains ne sont plus à l’image des anciens rebelles ou des dissidents. Leur attitude ne dessine aucun horizon ; elle ne les dispose pas à une action critique pour agir ; elle n’a aucune dimension prophétique. Ils expriment simplement de façon désordonnée et rageuse le fait qu’ils ne savent plus donner sens aux choses et trouver leur place dans le monde. Ils ne pensent du même coup pouvoir exister qu’en vouant symétriquement toujours plus aux gémonies un monde des « refusés » sous les diverses espèces de l’étranger, de l’immigré ou du « système » : ils doivent détester pour espérer. » C’est par ces mots que Pierre Rosanvallon conclut le deuxième chapitre de La contre-démocratie[1]. Ce constat dressé en 2006 précède de plus d’une décennie l’épisode des Gilets jaunes, et elle en est la description quasi clinique. Il explique aussi pourquoi, face à la deuxième vague de Covid-19, l’action politique, quel que soit le gouvernement en place, semble de plus en plus impuissante à emporter sinon l’adhésion, du moins à générer une forme d’accord populaire tacite.
L’hallucinante interview sur France Inter (au sens propre du terme, c’est en tout cas l’effet produit par cette rageuse logorrhée sur votre serviteur) de Geoffroy de Lagasnerie, qui enseigne en toute légalité à l’université, ou plutôt qui modèle les jeunes cerveaux comme il le revendique avec une assurance glaçante, me donne l’occasion de divaguer sur les lumineux enseignements de Pierre Rosanvallon.
Le procès en impuissance du politique est dirigé vers les gouvernants, alors qu’il s’agit d’un phénomène systémique : l’impuissance ne reflète pas le manque de volonté ou de caractère de ceux qui exercent le pouvoir, mais l’émergence d’une démocratie essentiellement négative. Il ne s’agit plus de conquérir et d’exercer le pouvoir (voyez la piteuse retraite en rase campagne des Brexiters pourtant victorieux en 2016), mais de contrôler et de contraindre les gouvernants jusqu’à l’impotence.
La notion d’impolitique développée par Pierre Rosanvallon permet de comprendre que la question politique majeure de notre temps est celle du défaut d’appréhension globale des conditions d’organisation d’un monde commun. L’essence réactive et contestataire des mouvements de contre-démocratie rabaisse et contraint le pouvoir mais ne cherche pas à structurer une vision collective.
Cette fragmentation des formes de contestation suggère à la fois une vitalité politique et une impasse. Vitalité car les différents modes de participation, concertation, consultation, contestation, revendication, etc... n’ont jamais été aussi nombreux, intenses et variés. Impasse, parce même si ces phénomènes procèdent d’une demande sociale croissante et d’une volonté sincère, de la part des gouvernants, de consolider la légitimité de la décision publique, ils dépolitisent la démocratie. Elle n’est plus le lieu de l’élaboration d’une perspective d’avenir commun, mais un espace de pures revendications parcellaires, et donc de déconstruction.
On comprend mieux pourquoi, face à la crise économique et sociale engendrée par le Covid-19, le piège du « quoi qu’il en coûte » se referme sur son émetteur. Il a libéré une multitude de demandes d’aides catégorielles – toutes justifiées, toutes urgentes, toutes prioritaires – et ne peut qu’engendrer de la confusion sur un terreau déjà largement propice à la faillite démocratique. Faut-il décider de maintenir ou d’interdire telle ou telle activité, indemniser à hauteur de tel ou tel montant, garantir des prêts sous conditions ou de façon indiscriminée, nationaliser temporairement ? Pourquoi mon voisin et pas moi ? La demande sociale infinie rencontre enfin une sollicitude politique infinie. Et le piège se referme : tout se passe comme si la démocratie s’effondrait sous le poids de sa propre efficacité – mais une efficacité dévoyée, c’est-à-dire appliquée à satisfaire des micro-clientèles en espérant qu’à la fin des temps la multitude fera le tout.
Il ne s’agit pas d’une faillite des élites – le procès est aussi ancien que la démocratie et trop facile – mais d’une crise de maturité de celle-ci. Ce « grand empêchement » prend des formes diverses. Du clownesque tragique trumpien à l’anticapitalisme émeutier français en passant par l’illibéralisme hongrois. Parce que les sources de ce phénomène sont à chercher dans le système démocratique lui-même (après tout, ce qui des élections libres qui portent au pouvoir des dictateurs ou des clowns tristes, et c’est au nom du droit de manifester que des émeutiers peuvent mettre à sac les Champs-Élysées) - seule la démocratie peut en traiter les causes. Et paradoxalement, la fin de l’empêchement passe moins par des réformes institutionnelles – sans doute nécessaires mais insuffisantes - que par une pratique renforcée du pouvoir. Non pas au sens autoritaire du terme, mais au sens anglo-saxon d’enforcement, c’est-à-dire de mise en application : assumer une vision et sa mise en œuvre. Ce qui suppose, ô révélation, d’avoir élaboré une vision convaincante de l’avenir et de disposer d’une légitimité suffisamment établie pour actionner sans trembler les leviers d’action adéquats. Un processus politique sûr de lui-même car débarrassé de la crainte paralysante de ne pas satisfaire tout le monde, tout le temps. Plus facile à dire qu’à faire, et exercice particulièrement périlleux en temps d’épidémie, où le gouvernement ne peut faire autrement que de compenser les effets dont il est - en partie - la cause.
[1]Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie, La politique à l’âge de la défiance. Seuil, 2006. Le deuxième chapitre intitulé « La souveraineté d’empêchement » a inspiré le titre de ce billet.