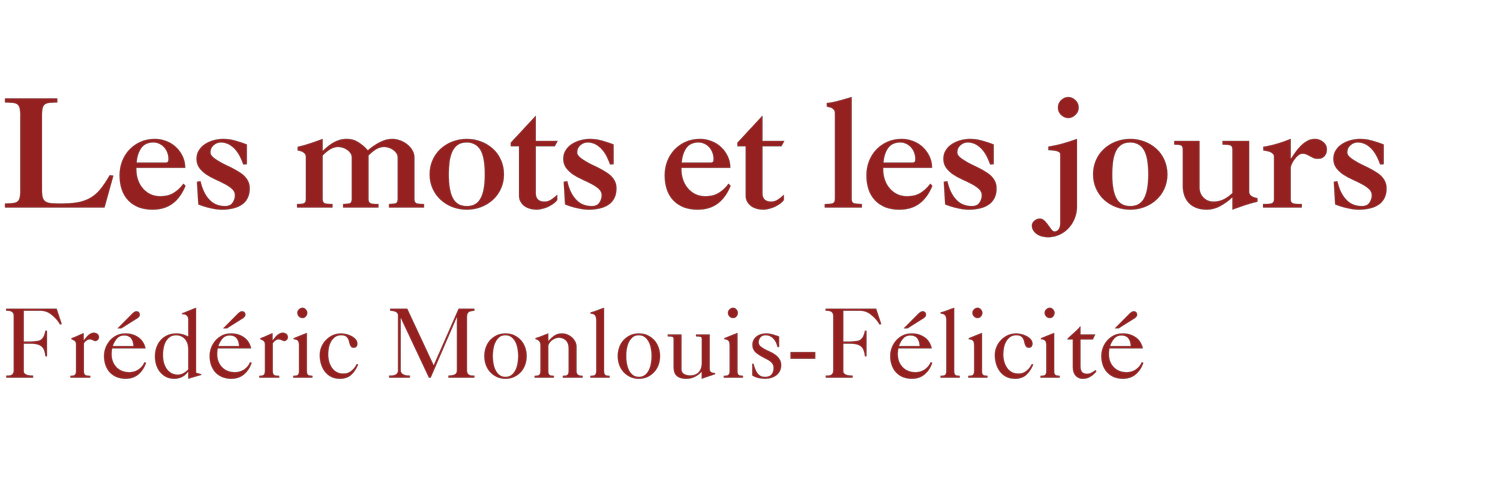Faire de l’avenir
Avec 58,4%, le taux d'abstention au second tour des municipales 2020 est supérieur de 20 points aux élections de 2014. Et encore, le calcul de l'abstention ne prend pas en compte les 3 millions de citoyens non-inscrits sur les listes électorales. A tel point que dans certaines communes comme Mulhouse, Vénissieux ou Vaulx-en-Velin, les maires n'ont été élus que par environ 10% des inscrits.
Ce taux record d'abstention nous rappelle cruellement à l'ordre : accomplir son devoir civique est une évidence de moins en moins partagée. Sans entrer dans les détails, le taux d'abstention a doublé aux élections municipales depuis les débuts de la Vème République. Même l'élection des maires, pourtant régulièrement célébrés comme les élus de proximité dans lesquels les Français ont le plus confiance, ne suscite pas l'enthousiasme. Les explications conjoncturelles ne manquent pas : intervalle de trois mois entre les deux tours ; impossibilité de mener une campagne classique ; crainte de la contamination ; préoccupation envahissante pour un quotidien incertain (école, emploi, perte de revenus, congés d'été...). Tour cela est juste, mais invoquer ces raisons ne suffit pas à rendre compte du mouvement de fond qui, d'élection en élection, rend le suffrage universel de moins en moins universel.
Paul Valéry a dit un jour que "La fonction la plus simple, la plus profonde, la plus générale de notre être (...) est de faire de l'avenir." Faire de l’avenir… étrange formule. L'expression vient d'un discours que Paul Valéry prononce en 1935, à l’occasion de la remise des prix aux élèves du lycée de la ville de Sète, dans le sud de la France, où il avait étudié des décennies plus tôt. Devant ces jeunes gens, ce n’est pas l’intellectuel et le poète sophistiqué qui parle, mais l’homme. A l’époque, il a 64 ans. Cinq décennies le séparent de son public. Pour lui, les mots ont un sens. Faire de l’avenir. Dans faire, il y a la main de l’homme qui façonne et pétrit, l’action, le travail, l’effort individuel. Il y a aussi l’idée qu’une forme de responsabilité existe, puisque cette action, celle de faire, demande volonté et énergie. Il ne prononce pas non plus le mot avenir par hasard. L'avenir n’est pas ce qu’on attend, passivement, comme on attend que le temps change. L’avenir, c’est ce que l’on fait advenir, c’est l’idée transformée en action, et c’est l’action qui transforme le monde. Valéry s'intéresse à la vie intérieure avant tout (" L'avenir se confond en chacun de nous avec l'acte même de vivre. (...). La vie, en somme, n'est que la conservation d'un avenir ") mais sur le plan collectif, faire de l’avenir nous renvoie aussi à notre responsabilité première : construire un monde meilleur pour les générations futures.
Et voilà que ces générations futures désertent en masse le jeu démocratique : en juin 2020, le taux d'abstention a été supérieur de 30 points chez les moins de 35 ans par rapport aux plus de 60 ans. Nos démocraties représentatives libérales se sont bâties sur l’hypothèse qu’un corps d’élus devait décider de ce qui est bon pour notre avenir commun. C’est à ces élus que nous conférons le pouvoir de faire de l’avenir en notre nom et c'est souvent leur faible efficacité qui explique le désenchantement démocratique. On peut toujours incriminer l’imperfection des systèmes partisans qui biaisent la sélection des candidats. Mais le renouvellement historique des députés français en 2017 a aussi montré ses limites. La préférence pour le court-terme est probablement une faille encore plus puissante que le défaut de représentativité. Nos élus ont tendance à privilégier ce qui se voit aujourd’hui. Ce qui compte pour exister politiquement et médiatiquement c’est ici et maintenant, le court terme et le visible.
Le nœud du problème est là : l’avenir est invisible, l’avenir n’a pas de voix, le long terme peut attendre. Si on ne modifie pas en profondeur l’incitation des élus à prendre la bonne décision, le court terme sera toujours vainqueur. Et quelle meilleure incitation pour un homme politique que d’être élu ou réélu ? C’est pourquoi la solution la plus puissante pour injecter du long terme dans le processus de décision politique consiste à l’injecter à la source, c’est-à-dire dans l’élection elle-même. Donner plus de poids au long terme grâce au bulletin de vote changera la physionomie de tout le système politique. Comment faire ? Une façon puissante - et à ma connaissance jamais explorée - est le suffrage générationnel, qui consiste à pondérer le vote en fonction de l’âge.
Est-ce la fin du suffrage universel, le viol de la démocratie ? Un homme = une voix est une convention récente, qui avait pour but de mettre fin au suffrage censitaire, ce droit de vote fondé sur la naissance et l’argent. Le suffrage générationnel reconnait une réalité universelle : les jeunes ont plus de droits sur l’avenir que les vieux. Ce sont eux, les jeunes, qui subiront pendant des décennies les conséquences des choix pris par plus vieux qu’eux. Donner plus de poids au vote des 18-35 ans qu’au vote des plus de 65 ans n’est pas de la démagogie, mais de la sagesse.