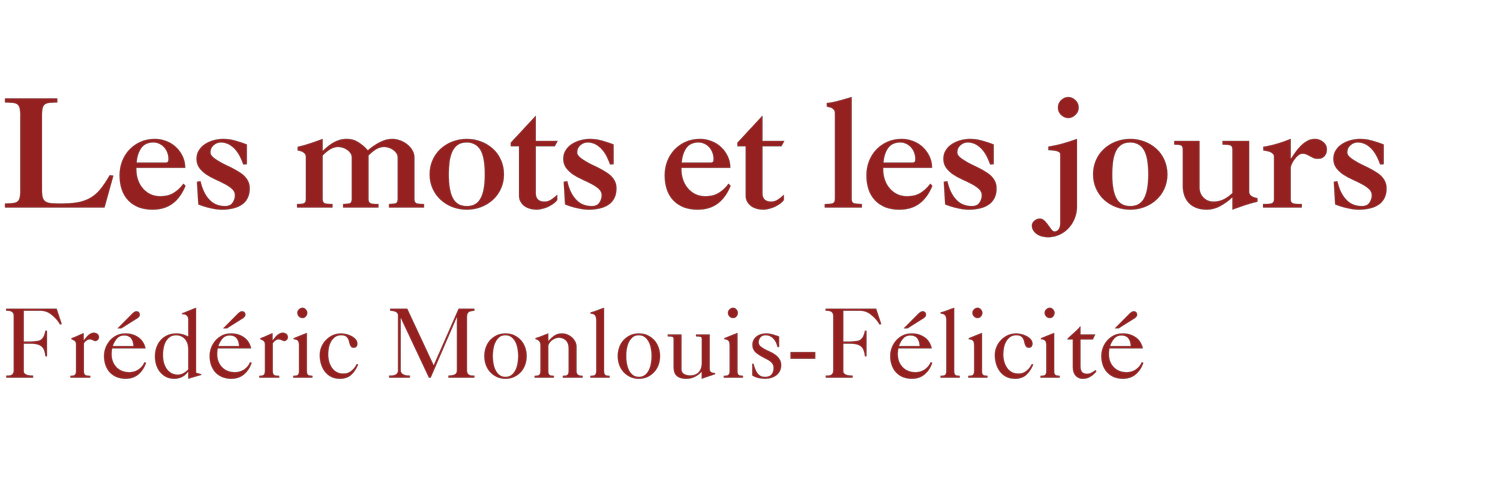Résilience, j'écris ton nom
Opération résilience.
Ça sonne moins bien qu'opération Overlord, mais quand même, ça pose son chef de guerre. Au moins, ça fait sérieux, loin des rodomontades trumpiennes ou bolsonariennes. Lancée le 25 mars 2020, l'opération consistait à mettre au service des populations et des pouvoirs publics des moyens militaires pour lutter contre le Covid-19. A l'époque, saisis par la crainte de la contagion, comme des lapins dans les phares d'une voiture, peu de commentateurs se risquaient à remettre en question sinon l'intérêt de cette opération, du moins celle de la pertinence de ce mot : résilience. Mais au fait, pour emprunter la novlangue d'Alain Badiou, de quoi la résilience est-elle le nom ?
Comme le savent les ingénieurs, le champ originel de la notion de résilience est celui des sciences physiques. Il s'agit de la capacité des matériaux à résister aux chocs sans rompre et à revenir à l'état initial. Les psychiatres américains spécialisés dans la petite enfance ont adopté le mot dans les années 90, puis le psychanalyste Boris Cyrulnik l'a popularisé en France. Cyrulnik définit la résilience comme la capacité qu'ont certains enfants à surmonter les traumatismes qu'ils ont subis : deuil, abandon, maltraitance, violences sexuelles, guerre... Par extension, de nombreux secteurs ont adapté cette notion à leur champ disciplinaire : urbanisme, informatique, économie, écologie, etc...
S'il n'est évidemment pas question de remettre en question l'intérêt du concept dans le champ psychologique, l'invasion du domaine politico-sanitaire par cette notion mérite qu'on s'y arrête. Que nous dit-on quand on nous promet de la "résilience" ?
1. Vous êtes des enfants fragiles, susceptibles d'être frappés par la violence du monde, mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous protéger. Peuple de mineurs irresponsables. Nous nous occupons de tout, y compris de régler vos salaires, pourvu que vous renonciez à vos libertés fondamentales pendant une durée indéterminée. Ne cherchez pas à comprendre (et si vous n'avez toujours pas compris, nous vous répéterons en boucle des messages angoissants à longueur de journée). Et surtout restez chez vous.
2. Résilience n'est pas résistance, qui suppose un ennemi clairement identifié. Elle ne crée pas de cohésion nationale, pas de dynamique sociale, puisqu'elle n'est que la réception d'une agression indéterminée et aléatoire, due à un environnement soudain déréglé. Il faut encaisser le choc, et faire au mieux pour revenir à la situation antérieure. Un virus n'a pas d'agenda, pas de stratégie, pas d'idéologie, pas de cible. Si la résistance a un sens - faire face, se fédérer, contre-attaquer et vaincre - la résilience n'a pas plus de signification que celle d'un hérisson qui fait le dos rond en attendant que le danger passe. L'une a ses héros, l'autre ses technos.
3. En cela, la résilience est essentiellement passive. On ne construit pas de projet de société sur la capacité d'absorber un choc. Depuis la crise de 2008, les gouvernements successifs répètent à l'envi qu'il faut protéger les Français. Et, joignant le geste à la parole, ils transforment la France en champion du monde des dépenses sociales, des impôts, de la sur-administration et, dernièrement, du chômage partiel. Ultra-protégés dans une société ultra-résiliente, les Français ont de plus en plus de mal à se projeter dans l'avenir et dans la mondialisation.
4. A cette aune, la résilience apparaît comme le stade ultime du renoncement. Comme la peur dont elle est le fruit, elle nous paralyse. Figés, nous attendons que la foudre tombe, mais nous oublions que le monde continue de tourner dans notre dos. Avec la résilience fleurit la parabole du chêne qui résiste mais se brise dans la tempête tandis que le roseau plie et ne rompt pas. Mais avec des roseaux, on ne construit que d'éphémères huttes. Faire pousser des chênes prend infiniment plus de temps et d'énergie, mais nous savons ce que nous devons à nos forêts. Et pour filer la métaphore, mieux vaut un peuple de chênes qu'un troupeau de roseaux.
La relance post-Covid 19 doit permettre de sortir de toute urgence de cette logique mortifère pour remettre le pays dans une perspective d'avenir, grâce à l'immense potentiel technologique, industriel et culturel qui est le sien. Bref, pour éviter que la France n'entre dans l'avenir à reculons (Paul Valéry), laissons la résilience aux psychologues.